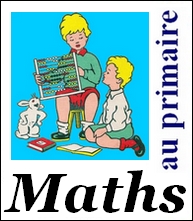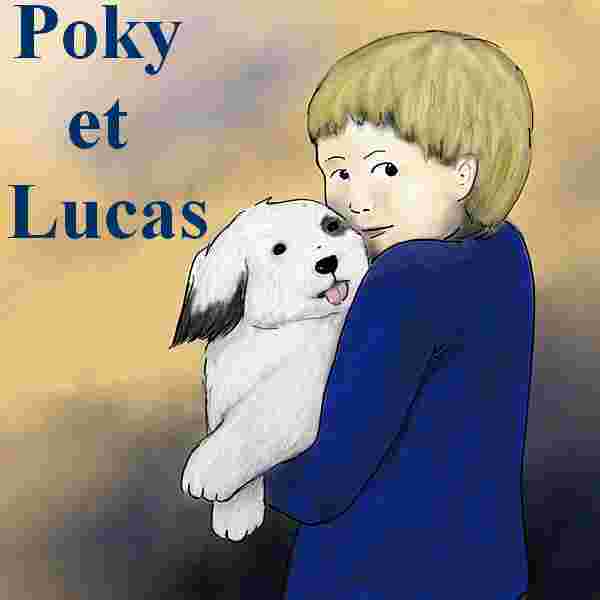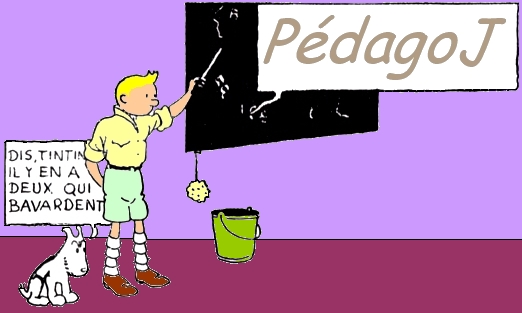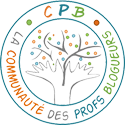-
Les Aventures de Tom Pouce - P.-J. Stahl (1843)
Télécharger « aventures tom pouce.doc »
AVENTURES DE TOM POUCE
I. Où il est question des parents de Tom Pouce
IV. Pourquoi Tom Pouce s’appelait Tom Pouce
VI. Enfance de Tom Pouce. — Il sait lire, écrire, compter et dessiner
VIII. Les oreilles de Tom Pouce et les colimaçons
X. Où il est question des défauts de Tom Pouce, et surtout de sa curiosité
XII. Tom est avalé par un meunier
XIII. Tom dans le ventre d’un poisson
XIV. Tom Pouce chez le roi Arthur.
XVI. On construit à Tom un palais ; mais il n’est pas ambitieux
XVII. Tom Pouce pense à ses parents, à la cabane et à la vache
XVIII. Tom Pouce est fait chevalier de la Table ronde
XX. Dessins tirés de l’album du roi.
XXI. Grand combat. — Tom a un cheval tué sous lui
XXII. Le grand Merlin, vient à son aide
XXIV. Tom revoit son père et sa mère
XXV. Le pauvre Tom retourne à la cour. — Le bouillon du roi
XXVI. Les prisons de Tom Pouce
XXVII. Condamnation de Tom Pouce
AVENTURES DE TOM POUCE.
PROLOGUE.
Octave faisait un bruit d’enfer. Il voulait absolument faire d’Emmanuel son cheval; Emmanuel s’y refusait : « J’aime mieux jouer à la diligence, s’écriait-il, et que tu sois le cheval. »
Grande bataille.
La petite Marie, assise dans un fauteuil, lisait, — à rebours, — un volume des contes des fées, et bavardait avec le petit Chaperon rouge. Fanny offrait un bonbon à sa poupée. Georgette jouait toute seule, mais tout haut, à la madame. Berthe sautait à la corde. Le petit Charles soufflait dans une trompette.
« Taisez-vous, taisez-vous, s’écria leur grand’maman, poussée à bout, ou je sonne votre bonne et dans un quart d’heure vous serez tous au lit... »
Grand silence.
Emmanuel respire. Octave s’essuie le front. Marie se contente de parler par signes. La poupée ayant refusé le bonbon, Fanny le mange. Georgette réfléchit. Berthe se couche sur le tapis. Le petit Charles s’arrête tout court. Et Octave, s’approchant alors de sa grand’maman: « Grand’maman, dit-il, si tu veux nous raconter une belle histoire, je suis sûr que nous serons tous bien sages. »
- Oui, oui, s’écria toute la bande, bien sages.
- Je le veux bien, » dit la bonne mère avec résignation; et voici ce qu’elle leur raconta, non sans l’avoir fait précéder toutefois de l’indispensable préambule qu’on met en tête de tous les contes :
« Mes enfants, c’est encore, à l’heure qu’il est, une grande question de savoir s’il y avait véritablement autrefois des fées, des enchanteurs et des génies. Il paraît à peu près certain qu’il n’y en avait pas, et que toutes les belles choses qu’on en a dites ont été inventées pour amuser des enfants comme vous. Mais ce qui ne fait pas de doute, malheureusement, c’est qu’aujourd’hui il n’y en a plus. Aussi la mode des fées a-t-elle un peu passé, et au lieu de ces jolis contes qu’on vous contait si bien, ne vous fait-on plus guère que de vilaines histoires qu’on vous conte assez mal et qui vous ennuient très-fort.
« Pour moi, qui suis presque aussi vieille et aussi passée que les fées, j’aime les fées et leurs histoires merveilleuses. Je les trouve parfaites pour les petits enfants comme vous et plus faciles à comprendre, et plus utiles à entendre, n’en déplaise à quelques jeunes dames (pour lesquelles Perrault, mesdames d’Aulnoy, le Prince de Beaumont et autres ont eu tort d’exister probablement), que toutes les dangereuses vérités qu’on vous débite. Vous êtes si petits, que je n’entreprendrai point de vous parler comme si vous étiez grands. Mon lot est de vous amuser en exerçant votre imagination au profit de votre coeur. Il sera toujours bien assez temps de s’adresser à votre raison quand vous serez en âge d’en avoir.
« Il ne faut pas demander des fruits à un jeune arbre, mais bien des fleurs seulement. Je suis trop vieille pour tomber dans une erreur comme celle-là. Aussi est-ce tout bonnement un conte des fées, — les Nouvelles et seules véritables aventures de Tom Pouce, — que je vais vous raconter.
« L’histoire de ce héros nous est venue jadis d’Angleterre, mais tellement défigurée et si injurieuse pour lui, et d’un si fâcheux exemple, que j’ai cru devoir la refaire à peu près tout entière pour votre usage, mes chers enfants, et sur les documents les plus authentiques.
« Vous n’apprendrez pas dans ce petit livre, j’en ai bien peur, tout ce que vous aurez à savoir un jour; mais vous y rencontrerez, à l’occasion, quelques-unes de ces leçons dont, entre nous soit dit, vous avez bien besoin quelquefois, mes chers petits. »
I
OÙ IL EST QUESTION DES PARENTS DE TOM POUCE.
Il était une fois, sous le règne du roi Arthur, une brave femme qui était très charitable, et qui avait d’autant plus de mérite à l’être qu’elle était pauvre. Pour toute fortune, elle possédait un champ qui n’était guère grand, et une vache. Mais son mari, qui était un brave homme, comme elle était une brave femme, remuait si bien le champ et le labourait avec tant d’ardeur ; et, d’un autre côté, le lait de la vache était toujours si bon, qu’ils vivaient contents ou à peu près dans leur petite demeure. J’ai dit à peu près, parce qu’il leur manquait en effet, comme à bien d’autres, quelque chose pour être heureux tout à fait. « Pour qui travaillons-nous, se disaient-ils, et à qui reviendra notre cabane ?
« Qu’est-ce qui labourera notre champ quand nous serons vieux ? s’écriait quelquefois le mari. Qu’est-ce qui portera à la ville le lait de la vache ? disait la femme à son tour. Il nous faudrait un enfant ! » s’écriaient-ils tous deux ! Et comme il est toujours bon d’espérer : « Attendons, reprenaient-ils, et espérons. »
II
L’ENCHANTEUR.
Un matin, dès l’aurore, l’enchanteur Merlin (c’était alors le beau temps des enchanteurs), un matin, dis-je, l’enchanteur Merlin, voulant sans doute mettre à l’épreuve la bonté de ces braves gens, s’en vint déguisé en mendiant frapper à leur porte et y demander l’aumône. La pauvre femme, qui était seule, parce que son mari était déjà dans le champ, le fit entrer pour qu’il pût se reposer, et lui donna pour se refaire tout ce qu’elle possédait, c’est-à-dire du pain noir et du lait; mais elle le fit de si bonne grâce, et la nappe sur laquelle tout cela était servi était si blanche, que le grand Merlin assura qu’il n’avait, de sa vie, fait un meilleur repas, et que pour la récompenser il se fit connaître d’elle, promettant de lui accorder tout ce qu’elle pourrait souhaiter.
« Monsieur l’enchanteur, dit la bonne femme tout émue, j’ai un bon mari, j’ai un champ ensemencé, j’ai aussi une vache et la cabane où vous êtes, mais je n’ai point d’enfant. Ah ! si j’avais un enfant ! » dit-elle ; et elle ajouta en pleurant : «Oui, un enfant ferait notre bonheur, ne fût-il pas plus grand que mon doigt...
— Mon Dieu oui, » dit le mari, qui était revenu sur ces entrefaites.
Cette demande réjouit fort le grand Merlin, qui ayant bien regardé, sans en avoir l’air, le doigt de la pauvre femme, la quitta en lui disant qu’il ne fallait désespérer de rien, et avec l’idée de la satisfaire.
III
LA REINE DES FÉES.
Mais comme le pouvoir des enchanteurs n’allait pas jusqu’à créer, Merlin résolut de se faire aider dans cette circonstance par la reine des fées ; s’étant donc mis en route à travers les airs, il se rendit chez elle et lui exposa, après les compliments d’usage, les motifs de sa visite.
La reine des fées, qui était naturellement très obligeante, ne se fit pas prier, quoique, dit-elle, il fut aussi difficile, en matière de création, de créer un petit enfant qu’un gros ; et dans l’année, la pauvre paysanne eut un fils, mais si petit, si petit, que quand on l’eut mesuré, on trouva qu’il n’était pas plus grand en tout que le pouce de sa mère.
« Bah ! bah ! disait le père aux voisins émerveillés, il grandira. »
Le nouveau-né, du reste, était si gentil et si bien pris dans sa petite taille, que les connaisseuses étaient obligées d’avouer que c’était une perfection. Il était aussi tellement vif et si remuant, qu’on avait toutes les peines du monde à le contenir dans sa couchette qui avait été faite, dans le premier moment, d’un sabot neuf au fond duquel on avait mis un peu de ouate bien douce et bien chaude, pour qu’il pût dormir tout à son aise.
IV
POURQUOI TOM POUCE S’APPELAIT TOM POUCE.
Il fallut lui donner un nom. Pour ne pas laisser son œuvre imparfaite, la reine des fées voulut être sa marraine ; elle vola donc vers la cabane où reposait son nouveau protégé, et le nomma de son premier nom Tommy, dont on fit Tom par abréviation, et du second, Pouce, en raison de la petitesse de sa taille et en mémoire du souhait de sa mère.
Après l’avoir nommé, elle le doua de tous les dons précieux qui faisaient que les enfants nés au temps des fées n’avaient qu’à le vouloir pour être des enfants accomplis ; malheureusement, alors comme aujourd’hui, ils ne le voulaient pas toujours.
Pendant la cérémonie, d’autres fées, sur son ordre lui préparèrent une toilette appropriée à sa taille. La chose fut bientôt faite; pour chemise, il eut (on l’assure, du moins) une toile d’araignée, et pour habit les deux ailes d’un brillant scarabée, qui consentit à s’en défaire quand il sut à qui on les destinait; on découpa ses culottes dans une cosse de pois, ses bas dans la pelure d’une pomme; ses souliers furent faits avec une peau de souris tannée, le poil en dedans; pour coiffure enfin, d’une feuille de chêne, on lui arrangea une jolie casquette qui lui allait à ravir, et, par-dessus tout cela, on lui passa une petite jaquette que sa marraine lui avait fait filer par le plus habile de ses vers à soie.
Le reste de son trousseau se composait de deux jolies cravates qui étaient si délicates, qu’elles auraient passé à travers le trou d’une aiguille, de quatre mouchoirs brodés à tous les coins, et d’un ravissant petit bonnet de coton.
La reine des fées lui fit en outre des cadeaux magnifiques qu’elle tira d’une cassette que son nain avait toujours sous le bras, et en cela, toute reine des fées qu’elle était, j’oserai dire qu’elle pouvait bien avoir tort, car elle risquait de donner à Tommy, qui était pauvre, le goût des richesses, un des goûts le plus dangereux qu’on puisse avoir quand on n’a rien pour le satisfaire. Toujours est-il qu’elle lui donna, pour remplacer le sabot dans lequel elle l’avait trouvé couché, un berceau fait avec la coquille d’un œuf qui provenait de cette poule qui ne pondait que des œufs d’or. Les rideaux étaient tissus de fils de soie entremêlés de fils d’argent, et parsemés d’étoiles de diamants qui dessinaient, en caractères lisibles, l’histoire de tous les enfants célèbres depuis le commencement du monde. Des mies et des berceuses étaient occupées du soir au matin, et du matin au soir, à bercer le petit Pouce, et des colibris perchés sur le baldaquin faisaient entendre, pour l’endormir, des chansons dont voici à peu près le sens :
Do, do,
L’enfant do,
L’enfant dormira
Tantôt.
Mais celles-ci avaient beau bercer, et ceux-là avaient beau chanter, le petit Tom, que toutes ces cérémonies impatientaient, ne dormait guère dans son riche berceau et, ce qui prouva bien qu’il devait être un jour un garçon de sens, c’est qu’il semblait préférer le sabot dans lequel on l’avait mis avant l’arrivée de la fée sa marraine, et qu’il ne s’endormait guère que quand on l’y couchait. Il s’ensuivit que petit à petit le beau berceau fut relégué dans une armoire où il resta comme une curiosité.
Quant aux berceuses, voyant qu’elles n’avaient plus rien à bercer, elles s’en allèrent ; et quant aux colibris, ils disparurent à la grande satisfaction du père et de la mère de Tommy, dont les goûts simples s’accommodaient mal de ces colifichets.
Ce fut donc dans ce sabot que Tom grandit, ou plutôt qu’il ne grandit pas. Mais si sa taille resta la même, son intelligence fut si précoce, que ses parents ne souhaitèrent jamais qu’il fût plus grand.
Sa mère guida ses premiers pas, et elle le fit avec tant d’habileté, que bientôt Tom put marcher tout seul, et qu’il n’usa pas beaucoup de lisières.
V
VIE PRIVÉE DE TOM POUCE.
Rien n’était si agréable que de voir le petit Tommy chez lui, au milieu de tous les ustensiles qui servaient à ses usages journaliers. Sa maman lui avait acheté, chez un prédécesseur de Giroux, un beau ménage de 25 sous (dans ce temps-là, les ménages étaient encore à bon marché), et tout ce qui n’était pour les autres enfants qu’un joujou étant proportionné à sa taille, Tom se trouvait avoir pour table, pour verres et pour assiettes, les tables, les verres et les assiettes avec lesquels les autres enfants font d’ordinaire la dînette, quand ils n’ont à dîner que leur poupée.
Pour tout dire, quoique Tommy eût bon appétit, il mettait six jours à manger un macaron, car c’était pour lui comme un pain de quatre livres pour un autre. Son fauteuil était une chose extrêmement curieuse; son père qui était fort adroit, l’avait fait lui-même avec des arêtes de poisson, et au lieu de paille il avait été obligé d’arracher, pour le couvrir, plusieurs cheveux à sa femme qui les avait fort beaux. Le reste était à l’avenant.
VI -
ENFANCE DE TOM POUCE.
IL SAIT LIRE, ÉCRIRE, COMPTER ET DESSINER.
L’enfance de Tommy fut, assurément, le temps le plus heureux de sa vie ; comme il était presque impossible d’avoir meilleur coeur qu’il ne l’avait, sa mère avait rarement occasion de le gronder, encore était-ce bien doucement, et n’eut-elle jamais besoin de se servir contre lui ni du martinet ni de la verge, qu’il ne connaissait même pas de nom, et qui font tant de peur aux méchants petits garçons.
Il apprit à lire en moins de rien, dans un joli livre que lui avait laissé sa marraine. Ce livre s’appelait le Livre des petits Enfants, et était rempli d’histoires qui étaient toutes plus jolies les unes que les autres, et d’images qui ne le cédaient en rien aux histoires. Tom y trouva aussi des fables qu’il apprit en un clin d’œil, et qu’il récitait à merveille et dès qu’on l’en priait.
A peine savait-il lire, qu’il demanda une plume et du papier, et se mit à écrire un beau compliment pour sa maman. Le plus difficile avait été de lui trouver une plume assez petite pour qu’il pût s’en servir, mais à la fin on en était venu à bout.
Son écriture était fine et déliée, ses lignes bien droites, et peu à peu il en vint presque à savoir aussi l’orthographe : « Je ne serai pas grand, disait-il parfois, mais je serai savant. »
Quand il sut écrire tout à fait, le goût des arts, et surtout le goût du dessin, se développa en lui; il composait déjà de fort jolies petites vignettes à un âge où les plus habiles ne font encore que des nez, des bouches et des oreilles.
C’était merveille que de voir les ravissants petits dessins qui couvraient ses cahiers. Il fit, après six mois de leçons, le portrait de son père et celui de sa mère d’une ressemblance si frappante, que, quoique ce fussent, on le pense bien, des portraits extrêmement petits, ceux qui avaient de bons yeux ne pouvaient les regarder sans s’écrier tout de suite en voyant celui du père: « C’est M. Pouce; » et en voyant celui de la mère : « C’est en vérité madame Pouce. » Car il faut dire que, contrairement à ce qui se pratique de nos jours, le père et la mère de Pouce avaient fini par prendre le nom de leur fils.
Quant à ce qui est de compter, on peut dire qu’aucun enfant ne comptait mieux que lui ; il savait ses quatre règles, et s’il y en avait eu plus de quatre à apprendre, il les eût apprises également.
Dans ses heures de récréation, il suivait quelquefois son père dans les champs, et là, armé d’un petit fouet, il défendait son déjeuner contre les moineaux, auxquels le pain ne manquait pas de faire envie. Mais, par exemple, dans les moments où il faisait du vent, on était obligé de l’attacher avec un fil à la tige d’un chardon, pour qu’il ne fût pas emporté, et il s’y reposait à l’abri des plus grosses tempêtes.
Quand il jouait, c’était à des jeux dont le pauvre petit était pour ainsi dire l’inventeur, et il le fallait bien, les jeux des autres enfants étant pour lui jeux de géants.
Il s’était fabriqué à lui-même une petite charrue semblable en tout à celle de son père et qui marchait toute seule, et il s’en servait si bien pour labourer son jardin, qui se composait d’un pot à fleurs dans lequel son père avait mis de la fine terre de bruyère, que les petites graines qu’il y semait y poussaient toutes à merveille.
Aussi, M. Pouce disait-il avec fierté : « C’est égal, si ce petit-là avait été plus grand, il serait devenu le meilleur jardinier de la contrée. »
Tous les matins, au temps des fleurs, Tom en offrait une, la plus belle éclose, à sa maman, qui l’embrassait en pleurant de joie de le voir si prévenant.
Et quand il y en avait assez, le charmant enfant tressait deux petites couronnes qu’il accrochait au-dessus des deux portraits de ses parents.
VII
LA VOIX DE TOM POUCE.
Je n’ai pas encore parlé de la voix de Tom ; aussi est-il bien temps que je dise que cette voix était la plus aimable et la plus flatteuse qu’on pût entendre, mais si faible, si faible, qu’il fallait y être bien habitué, ou avoir l’oreille aux aguets pour ne rien perdre de ce qu’il disait.
Sa mère, par exemple, distinguait aussi bien chacune de ses paroles que s’il eût eu une voix de tonnerre ; et d’ailleurs, à force de s’aimer, ils s’entendaient tous deux à ce point qu’ils n’avaient pas besoin de parler pour se comprendre, et qu’il leur suffisait de se regarder.
La faiblesse de la voix de Tom avait pour résultat qu’il parlait rarement, car s’il avait parlé davantage, il se serait nécessairement, fatigué la poitrine.
Mais ceci même eut un avantage pour lui; car, parlant peu, il écouta beaucoup, et acquit ainsi une foule de connaissances utiles, qui échappent nécessairement à celui qui ne fait que bavarder.
VIII
LES OREILLES DE TOM POUCE ET LES COLIMAÇONS.
Chose surprenante, Tommy avait l’oreille si subtile et si délicate, qu’il en vint à entendre parler des êtres que nous autres, avec nos grandes oreilles, nous croyons tout à fait dépourvus de l’usage de la parole.
Un jour Tom demanda à son père si les colimaçons parlaient ; son père n’hésita pas à lui répondre que les colimaçons ne parlaient pas. « Je crois pourtant qu’ils parlent, dit Tom, en demandant pardon à son père de n’être point de son avis, et je le crois parce que ce matin même j’en ai entendu deux tout au bas de la porte qui se parlaient entre eux.
— Et comment as-tu fait pour les entendre? dit M. Pouce, en riant dans sa barbe.
— Ma foi, dit Tom, je ne songeais guère à surprendre leur secret. Je m’étais mis, pour être à l’ombre, dans une coquille abandonnée ; ils vinrent à côté de moi sans se douter de rien, puis ils se mirent à parler, et je les ai entendus.
— Et que se disaient-ils ? dit M. Pouce, riant encore plus fort.
— Celui qui était le plus près de moi, répondit le petit Pouce, disait : « Il y a là-bas dans le jardin de M. Tom père deux abricots superbes qui ont l’air d’être mûrs et bons à manger. — Est-ce loin ? dit l’autre. — Non, répondit la première voix. Quand donc le soleil sera couché et que la nuit sera venue, nous sortirons de notre trou, et nous ferons un fameux souper. — Et celui qui nous le payera, ce sera M. Pouce père, » reprit la seconde voix.
— Les brigands ! s’écria M. Pouce indigné. Mais bah ! dit-il, c’est un conte que tu me fais là.
— Ce n’est pas un conte, dit le petit Pouce en engageant son père à guetter les deux colimaçons.
— Pardieu, reprit le père, si tu pouvais entendre le langage des bêtes, tu aurais là un singulier talent.
Mais qui fut bien étonné quand le soir fut venu ? ce fut M. Pouce, qui, s’étant mis en embuscade, surprit bientôt les deux voleurs, qu’il prit, comme on dit, en flagrant délit. Les deux abricots étaient déjà entamés.
Et qui fut bien attrapé ? ce furent les deux colimaçons qui payèrent de leur vie leur gourmandise, et qui, de plus, ne surent jamais comment on avait pu déjouer leur complot.
Une autre fois, il entendit pendant la nuit, comme un bruit de scie; il réveilla aussitôt sa maman. C’étaient les vers qui s’étaient mis dans le sac aux noisettes, et il y en avait déjà beaucoup de trouées ; grâce à Tom, celles qui ne l’étaient pas encore furent préservées. Mais en voilà plus qu’il n’en faut pour montrer que Tom avait des oreilles surprenantes.
IX
L’ÉPÉE DE TOM POUCE.
Nous avons oublié de dire que Pouce avait une épée ; cette épée était faite de la moitié d’une petite aiguille à coudre que sa marraine avait fait aiguiser et damasquiner à son intention, prévoyant bien qu’étant faible comme il l’était, il aurait souvent à se mettre en défense. Tom ne quittait jamais cette épée ; il couchait même avec elle, car il avait des ennemis auxquels des enfants d’une taille ordinaire sont rarement exposés. Une puce était pour lui un animal véritablement féroce, une araignée était un monstre redoutable, et quand il lui arrivait de rencontrer l’une ou l’autre, le pauvre Tom n’en était pas toujours quitte pour une piqûre ; et tout ce qu’il pouvait faire, c’était de tenir en respect son ennemi, jusqu’à ce que sa bonne mère vînt à son secours.
Un jour que Tom, après toute une matinée passée à sarcler son petit jardin, à ratisser les allées, à arroser une plate-bande de pâquerettes qu’il venait de semer, et à faire la guerre aux insectes, se reposait sur le bord d’un frais ruisseau sous une feuille qui le couvrait presque tout entier comme un immense parasol, il se sentit tout d’un coup piqué à la main ; il se leva, plein de colère, et n’apercevant autour de lui qu’un papillon de l’espèce qu’on nomme amiral, il crut que c’était là l’ennemi qui avait lâchement profité de son sommeil pour venir le blesser. Ayant donc dégainé, il leva sa formidable épée sur le malheureux papillon : c’en était fait du bel insecte, quand Tom, dont la colère commençait à se calmer, réfléchit qu’un papillon n’ayant point de dard, ce n’était point le papillon qui avait pu le piquer, et qu’il allait peut-être faire périr un innocent à la place d’un coupable. Ayant donc fait de plus actives recherches, regardé autour de lui, en bas et en haut, et passé successivement en revue tous les buissons, il découvrit, bourdonnant dans une épaisse touffe d’herbes, trois guêpes monstrueuses.
Si c’eût été des abeilles, Tom leur aurait peut-être pardonné; car enfin, si les abeilles piquent, en revanche elles sont bonnes à quelque chose, et le miel qu’elles fabriquent est bien fait pour plaider en leur faveur. Mais des guêpes, des êtres inutiles et malfaisants, c’était débarrasser la terre d’un fléau. Tom les attaqua bravement, et les ayant vaincues toutes trois, l’une après l’autre, et mises à mort, il les emporta chez lui comme un trophée de sa victoire.
Ce que nous en disons, c’est pour prouver que Tom était brave, et que dans son petit coeur il y avait un grand courage. La taille ne fait pas le héros, et il y a eu de par le monde de fort grands hommes qui n’avaient pas plus de quatre ou cinq pieds; on a vu très peu de tambours majors devenir colonels, et pour tout dire, l’histoire de David et de Goliath est une vieille histoire qui prouve du reste ce que je viens d’avancer.
X.
OÙ IL EST QUESTION DES DÉFAUTS DE TOM POUCE, ET SURTOUT DE SA CURIOSITÉ.
Si tout, ce que nous venons de dire donne à penser que Tom avait un grand nombre de qualités, il ne faut pas en conclure pourtant qu’il fût sans défauts.
Tom était curieux, et ce défaut unique fut cause que la jeunesse du pauvre enfant fut souvent fort orageuse.
Ses camarades jouaient une fois, devant lui, à la fossette; l’un deux, qui ne l’avait pas aperçu, vint cacher, avec un air de mystère, derrière la pierre sur laquelle Tom avait grimpé pour mieux juger les coups, un sac qui se fermait par deux cordons. Tom, intrigué, ne dit rien; mais quand son camarade fut retourné au jeu, il se laissa glisser tout le long de la pierre du côté du sac, jusqu’au fond duquel il parvint à s’introduire. Pauvre Tom ! au moment où il allait sortir, après avoir vu qu’il n’y avait rien dans ce sac que des noyaux d’abricots, comme il s’en trouve dans tous les sacs des écoliers, au moment, dis-je, où il allait sortir, le propriétaire du sac, qui avait perdu déjà les noyaux qu’il en avait tirés, revint pour faire une nouvelle provision, et prit Tom sur le fait. Comme la chance était contre lui, il était de mauvaise humeur : « Tu as voulu voler mes noyaux, dit-il à Pouce, je vais te punir. » Et ayant serré les cordons du sac, il secoua Tom si fort, que le malheureux, tout meurtri, fut obligé de demander grâce. Mais il eut beau protester de son innocence, et assurer que la curiosité seule l’avait conduit au fond de ce maudit sac, comme les apparences étaient contre lui, on refusa de le croire, et son honneur, ce jour-là, reçut une cruelle atteinte.
« Je ne serai plus curieux, » se dit Tom en sortant du sac.
XI
AFFAIRE DU PUDDING.
Mais un malheur n’arrive jamais seul, et, en cela, je trouve que la Providence, qui nous envoie plusieurs malheurs à la suite les uns des autres, n’a pas tort, comme on pourrait le croire ; car un seul, si gros qu’il fût, ne suffirait peut-être pas pour nous corriger.
Après cette aventure, Tom confus n’eut rien de plus pressé que de s’en retourner chez sa mère. Le hasard, qui voulait sans doute lui réserver une nouvelle leçon, le hasard fit que madame Pouce était absente, et que Tom ne trouva rien à là maison qu’un grand pot dont la vue l’intrigua d’autant plus qu’il était recouvert d’une feuille de papier. Il voulut savoir ce qu’il y avait dans ce grand pot, et il le sut ; car étant, en se servant comme d’une échelle d’une fourchette qui était là, parvenu à grimper jusque sur les bords, son pied glissa; et le papier, qui n’était point attaché, céda sous le poids du petit curieux. Ce pot était plein d’une pâte liquide que sa mère avait préparée pour faire un gâteau ; on croit généralement que c’était un pudding. Plaignez notre héros, quoiqu’il fût bien coupable ! car ce fut la tête la première qu’il tomba dans cet océan enfariné.
En ce moment, madame Pouce rentra ; et ayant regardé sa terrine, que devint-elle quand elle s’aperçut que sa pâte remuait toute seule, comme si le diable lui-même eût été au fond ?
C’était le pauvre Tom qui se démenait, qui se démenait, il fallait voir ! Pour madame Pouce, elle était bien loin de penser à son fils qu’elle avait vu sortir quelque temps auparavant.
Elle crut d’abord qu’une souris s’était peut-être laissée choir dans sa pâte; mais elle réfléchit qu’une souris n’eût point pris la chose tant à coeur; et comme elle était superstitieuse, elle s’arrêta à l’idée que son gâteau était ensorcelé. C’est pourquoi, saisie de frayeur, elle prit sa terrine en détournant la tête, et en versa tout le contenu par la croisée, sans s’apercevoir qu’elle y jetait en même temps le pauvre Tom.
XII
TOM EST AVALÉ PAR UN MEUNIER.
Un meunier, qui revenait de la ville à cheval sur son âne, passait au même moment sous la fenêtre, en chantant à tue-tête. La partie du pudding dans laquelle le pauvre Tom se trouvait tomba juste dans la bouche du meunier, à l’instant où celui ci aspirait l’air à pleine poitrine pour faire une de ses plus belles roulades ; de sorte que l’infortuné Tom entra comme une lettre à la poste dans ce gosier bien ouvert. Le fait, je le sais, est invraisemblable ; mais l’histoire est là, et je n’y dois rien changer, quoique, à vrai dire, cette partie des aventures de Tom soit fort peu de mon goût.
Le meunier fut si étonné, que son âne, qui allait d’un bon pas, eut le temps de le mener bien loin de la maison de M. Pouce avant qu’il fût revenu de son étonnement, de façon qu’il lui aurait été tout à fait impossible de dire d’où était tombé le pudding ; et comme, après tout, il finit par s’apercevoir qu’il avait eu plus de peur que de mal, il oublia ce qui venait de lui arriver et voulut se remettre à chanter. Mais c’était peine perdue ; il eut beau faire, il ne put y parvenir : d’où il conclut qu’il avait un chat dans la gorge.
Or, le chat, c’était le pauvre petit Tom, qui aurait bien donné tous les trésors de sa marraine, s’il les avait eus, pour être hors d’embarras.
Le meunier, à peine rentré chez lui, se plaignit d’un violent mal de gorge; et voyant qu’autour de lui personne ne comprenait rien à la nature de son mal, il songea à se mettre au lit et commença à s’inquiéter sérieusement; puis, comme le mal ne diminuait pas, il fit venir cinq docteurs et autant de prud’hommes; mais ils seraient venus au nombre de cinquante, que le patient n’aurait pas été plus avancé. Et en effet, comment expliquer un mal si étrange ? On entendait sortir de son gosier comme une petite voix lamentable qui criait de temps en temps : « Maman ! maman ! »
Tandis que les médecins étaient à se disputer sur les causes de ce phénomène, notre meunier vint à bâiller (que n’avait-il bâillé plus tôt?), et Tom, saisissant l’occasion, piqua hardiment une tête et retomba adroitement sur ses pieds au beau milieu des docteurs assemblés.
Qui fut penaud?
Ce fut le doyen des médecins, qui ne put nier que, dans cette occasion, toute sa science avait été en défaut.
Quant au meunier, voyant le pygmée qui l’avait tant inquiété, il l’empoigna brutalement par les cheveux et le lança dans la rivière.
XIII
TOM DANS LE VENTRE D’UN POISSON.
Il semblerait, en vérité, que le pauvre Tom fût venu au monde (comme les pilules) pour être avalé; car un énorme poisson qui passait par là, l’ayant vu tomber, le happa au passage, et l’avala à son tour, comme il eût fait d’une mouche. Après quoi, ayant été pris lui-même par des pêcheurs, il fut trouvé si beau, qu’on le porta au cuisinier du roi Arthur.
On ne peut se faire une idée de la surprise du cuisinier, quand, ayant ouvert le poisson, il en vit sortir le petit Tommy ; peu s’en fallut qu’il ne crût avoir devant les yeux, d’un côté une baleine, et de l’autre le prophète Jonas. Mais, quel que fût son étonnement, la joie de Tom fut plus grande encore.
« Monsieur le cuisinier, dit-il, vous venez de me rendre là un service que je n’oublierai de longtemps, »
Mais le cuisinier était si troublé, qu’il n’entendit pas un mot de la harangue du petit Pouce, et l’ayant mis dans son bonnet de coton, il s’empressa de le porter au roi lui-même.
XIV
TOM POUCE CHEZ LE ROI ARTHUR.
Quand le cuisinier arriva chez le roi, Sa Majesté était encore couchée. Mais le cuisinier ayant crié à travers la porte qu’il avait quelque chose d’extraordinaire à lui montrer, le roi, qui avait assez dormi, ordonna qu’on le laissât entrer.
Sa Majesté n’eut pas plutôt aperçu le petit Tom, qu’elle le prit en affection : « Je n’ai jamais rien vu d’aussi petit, s’écriait-elle à chaque instant. Venez-vous de Lilliput, mon petit ami? »
Tom répondit au roi en lui contant son histoire, et il termina en disant : «Sire, je serais bien aise de retourner chez mes parents, qui doivent être inquiets de mon absence. »
Le roi répondit à Tom d’être tranquille, qu’il allait leur écrire pour les rassurer, et qu’il pourrait d’ailleurs bientôt s’en retourner. Tom, voyant qu’il avait affaire à un bon prince, lui demanda sa main à baiser, ce qui lui fut accordé.
Le roi, qui se sentait en appétit, ayant alors assigné à Tom pour gouvernante une des princesses de la cour, le pria de s’en aller, en lui disant qu’il avait à s’occuper des affaires de l’État, mais qu’il le reverrait dans la soirée, et qu’en tout cas il ne manquerait pas d’écrire à ses parents avant le départ du courrier. Mais il l’oublia; parmi tant de promesses qu’ils ont à faire, les rois peuvent bien en négliger quelques-unes.
Tom n’était plus là, que le roi Arthur disait encore, en prenant son chocolat : « Je n’ai rien vu d’aussi petit. »
XV
TOM RÉUSSIT A LA COUR.
Le petit Tom, du reste, avait été aussi surpris de voir le roi que le roi l’avait été de voir le petit Tom : car le pauvre garçon, élevé dans la cabane de son père, s’était toujours imaginé qu’un roi devait avoir quelque chose de particulier, et qu’il ne pouvait être fait comme un autre homme; aussi eut-il besoin de se le faire dire et redire plusieurs fois, pour croire que ce monsieur, qui ressemblait à tout le monde, était le fameux roi Arthur dont il avait tant entendu parler.
Mais, à part le premier moment de déconvenue, il faut dire que Tom, qui était philosophe, avait fini par s’arranger du roi tel qu’il était; ils devinrent même si bons amis, le roi et lui, que ce grand prince faisait ordinairement dîner Tom sur sa table, à côté de son assiette.
L’arrivée de Tom à la cour devint bientôt l’objet de toutes les conversations. Chacun voulait le voir, le toucher, l’entendre causer, l’embrasser, de façon que, dès le lendemain de son arrivée, le pauvre Tom était exténué. C’était à qui le tournerait, et le retournerait ; et le général en chef des armées du roi, qui avait de grandes moustaches et la vue basse, l’ayant pris maladroitement par les jambes, au lieu de le prendre par les bras pour l’approcher de son œil et le voir de plus près, Tom faillit avoir une congestion au cerveau.
« Où est donc mon sabot, s’écriait-il, ce sabot dans lequel j’ai passé de si douces nuits ? Et ma bonne mère, et mon père ? Fatale curiosité ! où m’as-tu conduit ! »
XVI
ON CONSTRUIT À TOM UN PALAIS, MAIS IL N’EST PAS AMBITIEUX.
Si Tom eût été ambitieux, il eût pourtant pu être satisfait, car il n’y avait pas huit jours qu’il était à la cour, que le menuisier du roi lui avait bâti un fort joli petit palais qu’on avait placé tout meublé dans la chambre à coucher de la reine, dont notre héros était devenu le favori.
Ce petit palais améliora beaucoup le sort de Tom, car, au moins, avait-il de cette façon un chez lui, d’où il ne sortait que pour recevoir la visite des gens qui lui plaisaient.
Par exemple, il fallait obéir au roi, et ce n’était pas toujours fort agréable ; car le roi, qui aimait à rire, forçait le pauvre Tom à faire devant lui des gambades, à marcher sur les mains, et à exécuter encore bien d’autres tours pour s’en amuser. Et Tom, qui avait de la dignité, souffrait d’être obligé de faire ce métier de baladin; car, disait-il : « Sauter devant le roi, comme je le fais, ou devant de pauvres diables, comme le font les saltimbanques, c’est toujours sauter. »
XVII
TOM POUCE PENSE À SES PARENTS, À LA CABANE ET À LA VACHE.
Il n’osait plus reparler du désir qu’il avait eu d’aller revoir ses parents, car il s’apercevait bien qu’il était gardé à vue, et qu’on ne le laisserait pas partir volontiers.
Le roi couchait dans une vieille tour au haut de laquelle il y avait une terrasse. Tom, pendant que le roi était absent, montait prendre l’air sur cette tour, et il ne manquait jamais de se tourner, en pleurant, du côté où était la cabane de ses parents.
Voyant bien que le roi avait oublié la promesse qu’il lui avait faite de leur écrire, il prit le parti de leur écrire lui-même pour leur faire savoir qu’il n’était pas mort et où il était, leur recommandant bien de venir le chercher dès qu’ils le pourraient.
« Mon cher papa et ma chère maman, leur disait-il, j’ai ici tout ce qu’il me faut et au delà : je ne bois que des limonades, je ne mange que de la crème, j’ai des gâteaux à profusion, mais je donnerais tout cela pour une seule goutte du lait de notre vache. »
La lettre écrite, comment l’envoyer ? Il mit un grain de plomb dans l’enveloppe, et la jeta par la fenêtre. « Quelque âme charitable passera peut-être, se disait-il, qui mettra ma lettre à la poste. »
Dès le lendemain, le petit Tom profita du premier moment de liberté qu’il eut pour monter sur la tour, et là, les yeux fixés sur la route qui menait dans son pays, il regardait s’il n’apercevait point de loin le jupon rouge de sa mère, ou le chapeau à trois cornes de son père, mais il ne vit rien. Les jours suivants, le pauvre Tom remonta bien souvent à son observatoire. Il y avait tout au fond du paysage une grande forêt. Plus de cent fois Tom s’imagina voir sortir de cette forêt sa tendre mère qui lui tendait les bras, mais il se trompait; car ses parents, qui le pleuraient comme mort après l’avoir attendu bien longtemps, n’avaient pas même reçu sa lettre qui s’était, tant elle était légère, perdue dans les airs, le grain de plomb ayant crevé le papier avant qu’elle fût par terre.
Il s’adressa alors à sa marraine, la reine des fées; mais les fées avaient alors tant de filleuls, qu’elles ne pouvaient être toujours prêtes à les servir. Et qui sait, d’ailleurs, si cette sage fée ne voulut pas, dans l’intérêt même de Tom et pour le corriger tout à fait, le forcer à se tirer d’embarras lui-même?
Tom, qui ne savait que faire, s’amusa un jour à dessiner. La reine, qui vit son dessin, en fut tellement enthousiasmée, qu’elle le montra à tout le monde, et il ne fut bientôt plus bruit d’autre chose que du talent extraordinaire de Pouce pour la peinture.
XVIII
TOM EST FAIT CHEVALIER DE LA TABLE RONDE
Le roi, qui aimait les arts par-dessus tout, fut enchanté de voir que son petit Tom avait une qualité de plus; et voulant lui donner une marque de satisfaction, non content de lui conférer tous les ordres du royaume, il le fit chevalier de la Table ronde, et l’appela Tom Ier.
L’habit de Tom, qui était fort râpé et même percé en plusieurs endroits, et notamment aux coudes, n’étant plus en rapport avec sa nouvelle condition, on fit venir le tailleur de la cour qui lui confectionna un équipement complet, habit, veste et culotte; le tout en étoffe du plus haut prix et fait à la dernière mode.
La reine ajouta à ce don, pour les cas de guerre ou de -tournoi, une cuirasse faite d’un seul diamant, un fort beau sabre bien affilé et une cotte de mailles, tout en or et d’un travail si fin, que la pointe de la plus fine aiguille n’aurait pu la traverser. Le reste était à l’avenant, et se composait d’un casque taillé dans une opale, qui jetait ses feux chaque fois que Tom remuait la tête, et dont l’aigrette, qui se balançait au moindre vent, était faite d’une petite pluie fine d’eau de senteur solidifiée, et enfin d’un superbe cheval de bataille richement caparaçonné; ce cheval était un rat musqué de la plus rare espèce. Nous nous garderons bien d’oublier le beau carrosse d’apparat, dans lequel tous ces cadeaux furent apportés au nouveau chevalier, et qui était traîné par quatre petites souris blanches.
XIX
TOM FAIT DES CARICATURES.
Le roi ayant remarqué que Pouce, tout petit qu’il était, voyait très juste et saisissait parfaitement les travers des gens, lui envoya son album, sur lequel il lui dit de traduire à sa façon tout ce qu’il verrait, et surtout de ne pas épargner ses amis ni les gens de sa cour. Ce fut alors que Tom fit cette fameuse série de dessins qui donnèrent tant de prix à ce qu’on appelait alors l’album du roi. Ces dessins étaient sans doute, presque imperceptibles; mais en les regardant avec un verre grossissant, comme le roi ne manquait pas de le faire, ils prenaient des proportions raisonnables et étaient véritablement fort amusants; car ils formaient une critique spirituelle des choses et des gens de ce temps-là.
Tom, sur les ordres du roi, et avec le roi lui-même, qui sortait souvent déguisé, avait été dans tous les endroits où il y avait à exercer sa verve, les théâtres, les musées, les concerts, tous les lieux publics, les grands et les petits, les hommes d’État, les artistes, les gens de lettres, les livres, etc. Tout le royaume avait payé tribut à son crayon.
Tant et si bien que le roi n’eut de cesse que quand il eut fait, au grand désespoir de tous ceux qui s’y trouvaient attaqués, graver la collection des œuvres de Pouce.
Mais ce n’est pas tout rose que le métier de frondeur. A peine l’album du roi fut-il publié, que le petit Pouce eut des ennemis; car, si petit qu’il fût, son crayon le rendait redoutable.
XX
DESSINS TIRES DE L’ALBUM DU ROI
XXI
GRAND COMBAT. — TOM A UN CHEVAL TUÉ SOUS LUI.
Plus d’une fois il eut à se repentir de s’être laissé aller à son goût pour la critique, et notamment dans quelques circonstances malencontreuses où, ayant besoin de secours, il n’en trouva pas.
Un jour que Tom, monté sur son rat musqué, accompagnait le roi à la chasse, un chat énorme sortit tout à coup d’un fourré, s’élança d’un bond sur lui, et, avant que Tom eût le temps de se mettre en défense, emporta sur un arbre la monture et le cavalier; les courtisans qui se trouvaient là avaient bien vu la maudite bête, et rien ne leur aurait été plus facile que de lui barrer le passage, mais ils avaient profité de la distraction du roi, qui, en ce moment, regardait d’un autre côté, pour n’en rien faire. « Qu’il s’en tire comme il pourra, se disaient-ils, pourquoi s’est-il moqué de nous? »
Et ils n’eurent l’air de s’apercevoir de ce qui venait de se passer que lorsqu’il était déjà trop tard pour y porter remède. Quand le roi, en levant la tête, vit le danger que courait son petit favori, il ne put que s’écrier : «Ah! Mon Dieu ! » tant il en ressentit de peine.
Cependant Tom, quoique blessé, était parvenu à se débarrasser des griffes de son terrible adversaire, et, ayant dégainé, il le chargea si fort, qu’il le mit en fuite en le forçant d’abandonner son coursier. Malheureusement le pauvre rat musqué était mort dans la bagarre.
Ce combat fut d’autant plus glorieux, qu’ainsi que nous l’avons dit, il se passait sur un arbre, ce qui donnait tout l’avantage au chat, qui s’y tenait comme sur son terrain naturel.
Mais la victoire coûta cher au pauvre Tom; on le vit tout à coup chanceler, puis tomber. C’en était fait de notre héros, si le roi n’eût obligeamment tendu pour le recevoir son chapeau, dans lequel se trouvait par bonheur un mouchoir qui amortit la chute.
La chasse fut aussitôt interrompue, et on reporta Tom évanoui dans le palais du roi; quand la bonne reine le vit revenir dans cet état, elle faillit s’évanouir aussi, et renvoya toute sa suite, en ordonnant à chacune de ses femmes de ne parler que tout bas tant que la santé de Tom serait en péril; puis s’étant enfermée avec lui dans ses appartements, elle le soigna de son mieux, et le mit dans du coton avec des coussins de velours sous sa tête. Mais rien n’y fît, soins, ni peines, ni caresses. Et Tom, qui se sentait mourir, n’avait plus qu’un regret, c’était de mourir sans avoir revu son père et sa mère.
XXII
LE GRAND MERLIN VIENT A SON AIDE.
Le grand Merlin, qui n’avait pas perdu Tom de vue un seul instant depuis le jour de sa naissance à laquelle il avait, on s’en souvient, si fort contribué; le grand Merlin, dis-je, ayant vu le danger où se trouvait Pouce, alla trouver sa marraine et lui dit : « Pour cette fois, il faut le sauver, car il n’y a pas de sa faute. »
La reine des fées aussitôt monta avec l’enchanteur, qui se rendit invisible, dans son chariot volant, auquel étaient attelés plusieurs petits oiseaux, et elle entra par une fenêtre du palais dans la chambre de la reine, qui était encore au lit, car il était bon matin.
« Je viens chercher Tom, dit la fée à la reine, quand il sera guéri je vous le rendrai; » puis elle l’emmena dans son royaume.
La reine ne s’opposa point à ce brusque départ. Car enfin, se dit-elle : «C’est pour son bien qu’on me l’enlève. »
Mais quand le roi sut ce qui s’était passé, il entra dans une fureur épouvantable, et sortit pour rattraper Tom si c’était possible; mais il ne vit plus rien en l’air que quelques suivantes de la reine des fées qui volaient derrière son char. Il leur cria si fort de s’arrêter, et d’une façon si brutale, que l’une d’elles, s’étant retournée, lui cria du haut des airs qu’il était un mal appris.
Et c’est tout ce qu’il put en obtenir.
« Mais, lui dit la reine, pourquoi aussi vous fâcher, puisque j’ai la parole de la fée, et que Tom nous sera rendu ?
— Au fait, c’est vrai, dit le roi, et j’ai eu tort. Mais je ne saurais me passer longtemps de ce cher petit-là, je l’aime comme mon enfant, s’il avait seulement un pied de plus, j’en ferais l’héritier présomptif de ma couronne, et mes sujets auraient en lui un fameux monarque. »
Tom, arrivé chez sa marraine, n’eut pas de peine à guérir, car elle avait un baume qui guérissait toutes les blessures.
Dans le royaume des fées, Tom eût joui du parfait bonheur s’il n’avait été tourmenté par le louable désir de retourner chez ses parents. Il pria tant la fée, qu’elle se laissa fléchir, mais à condition qu’il ne resterait qu’une journée à la cabane où il avait vu le jour. Tom promit ; il le fallait bien.
XXIII
TOM REVOIT SES PARENTS.
Avant de partir, sa marraine lui dit d’aller prendre dans son trésor autant d’or qu’il en voudrait pour le porter à ses parents. La fée voulait par là l’éprouver, et voir si Tom aimait assez son père et sa mère pour se donner beaucoup de mal pour eux; mais Tom se tira de cette épreuve comme un bon fils le devait. Dès qu’il fut revenu de l’étonnement que lui avait causé la vue d’un si riche trésor, il prit, sans consulter ses forces, le plus gros écu d’or qu’il put trouver, et quoiqu’il eût à peine la force de le soulever et beaucoup de chemin à faire, il s’en chargea bravement, ne pensant qu’au bien-être que cette petite somme procurerait à ses pauvres parents.
Plus d’une fois les forces du pauvre garçon trahirent son courage, et il lui arrivait souvent dans le trajet de s’arrêter épuisé de fatigue, et de pleurer à côté de sa pièce d’or. Mais, bah ! il reprenait bientôt sa route et sa pièce. « Quand je vais revoir notre cabane, se disait-il, je serai bien payé de mes peines. »
La bonne fée, qui le voyait du haut des airs où elle était, avait bien envie d’en descendre pour l’embrasser, mais elle voulait lui laisser le mérite de sa bonne action pour qu’il l’accomplît jusqu’au bout.
A la fin, Tom s’avisa d’un expédient auquel il regretta de n’avoir pas songé plus tôt ; au lieu de porter cette pièce d’or, dont le poids l’écrasait, l’idée lui vint de la mettre sur le côté, et de la pousser devant lui comme un cerceau. L’idée était bonne, et elle lui réussit, aussi le reste de la route fut-il pour lui fort agréable, puisque chaque minute le rapprochait davantage de son but et sans fatigue.
Enfin il arriva.
XXIV
TOM REVOIT SON PÈRE ET SA MÈRE.
Toc, toc.
« Qui est là? dit tristement une voix dans la cabane. — C’est moi, dit Tom tout palpitant; moi, le petit Tom, votre fils. » .
La pauvre madame Pouce, entendant cette voix qui lui parlait, ne pouvait en croire ses oreilles. Bien sûr je rêve, se disait-elle, et je n’aurai point tant de bonheur de voir revenir mon cher enfant; personne n’a frappé.
Toc, toc, fit Tom pour la seconde fois, et pour la seconde fois il disait : « C’est moi, mère, votre petit Tom que vous croyez perdu. »
Il n’y avait plus à s’y tromper, c’était bien lui; la pauvre femme, toute tremblante, ouvre la porte, et Tom et elle étaient si heureux, qu’ils ne pouvaient parler.
Quand ils se furent bien embrassés, Tom, dont la petite figure s’attrista, dit : « Où est mon père? » Mais sa mère le rassura : « Il va venir, » dit-elle. Et au même instant M. Pouce entra.
Quand il vit son fils, il faillit tomber à la renverse.
Le roi dans son palais, et la reine des fées elle-même au haut des cieux, n’étaient pas si heureux que Tom, son père et sa mère dans leur pauvre cabane.
Quand le premier moment fut passé, Tom montra la pièce d’or; mais la pauvre mère le regardant, disait à son mari : « La plus belle fortune, la voilà. »
Après quoi Tom raconta ses aventures. Quand il arriva à la fin, et qu’il eut dit à ses parents qu’il avait promis de retourner, ce furent des larmes et des sanglots à fendre les rochers, mais ces braves gens n’essayèrent point de le retenir : « Va, lui dirent-ils en pleurant, un honnête homme n’a que sa parole. »
Et quand le jour fut écoulé, lui ayant donné une belle grappe de raisin pour sa route, ils ouvrirent la porte au pauvre Pouce désolé.
Mais derrière la porte ils trouvèrent la bonne fée qui leur dit tout bas : «Ne craignez rien pour votre fils, qui vous sera rendu ; vous êtes de braves gens, et le ciel vous doit le bonheur. Ne murmurez point et laissez-moi faire.
Ayant alors pris Tom dans sa manche, elle retourna avec lui dans son brillant palais.
« Ce n’est pas tout, dit-elle à Tom quand ils y furent arrivés, j’ai promis à la reine, épouse du roi Arthur, que tu lui serais rendu, il faut tenir sa promesse.
— Oui, sans doute, » dit Tom en poussant un gros soupir.
XXV
LE PAUVRE TOM RETOURNE A LA COUR. — LE BOUILLON DU ROI.
Un matin que le vent soufflait du côté du palais du roi Arthur, la reine des fées embrassa Tom et lui dit adieu ; puis l’ayant mis à cheval sur un courant d’air, elle souffla sur lui.
Et Tom flottant dans l’espace comme le liège sur l’eau, eut bientôt perdu de vue le palais de sa marraine.
Le voilà parti et volant sur des ailes invisibles, un peu essoufflé d’une course si rapide, et demandant quelquefois au vent de ne pas aller si vite. Mais bah ! le vent ne l’écoutait pas, et allait suivant ses caprices ordinaires; le malheur voulut qu’il fût dans un de ses mauvais jours, et il lui prit une bourrasque telle qu’une petite ombrelle que la marraine de Tom lui avait donnée en partant pour qu’il pût s’en servir au besoin comme d’un parachute, fut arrachée de ses mains, et que d’un seul coup le petit voyageur fut précipité dans la cour du palais.
La mauvaise étoile de Tom voulut que le cuisinier qui l’avait trouvé dans le ventre du poisson, passât par là portant une soupière contenant un bouillon pour le roi. Voyez le malheur ! Tom s’abattit au milieu de la soupière, et la soupe toute chaude jaillit en éclaboussures au visage du cuisinier qui, dans son effroi, laissa tomber le déjeuner du roi en criant au feu, au meurtre et à l’assassin.
Ce jour-là, le roi ne déjeuna pas, parce qu’il n’y avait plus de soupe dans le palais, et il en fut de si mauvaise humeur, qu’il écouta les mauvais rapports qui lui furent faits sur son favori par tous ceux que Tom avait blessés autrefois dans ses caricatures. Tom eut beau dire que c’était le vent, et que d’ailleurs il avait failli y perdre la vie, ce qui devait prouver à chacun qu’il n’avait pas voulu en faire un jeu, on n’en voulut rien croire, et pour qu’il ne pût s’échapper, on l’enferma, sans plus tarder, sous le chapeau du Roi, dont les bords furent assujettis avec soin par de grosses pierres.
XXVI
LES PRISONS DE TOM POUCE.
Tom dans ce noir cachot, se sentant fort de son innocence, ne perdit pas courage, et, tirant son épée, il tailla avec une adresse merveilleuse, une porte qui avait, ma foi, fort bonne grâce, dans la forme du chapeau sous lequel on l’avait emprisonné. Puis il sortit résolument et l’épée en main, bien décidé à vendre chèrement sa vie.
Mais Tom n’était pas encore au bout de ses disgrâces, car il était séparé de la liberté par tant d’obstacles (le palais était gardé de tous côtés), qu’il fut repris avant d’avoir pu les vaincre tous. Un hercule y eût succombé.
Pour cette fois ce fut, j’ai honte de le dire (tout est bon aux méchants pour arriver à leurs fins), ce fut dans une souricière qu’on l’emprisonna, lui, un chevalier de la Table ronde !
Là, pendant huit jours et huit nuits, l’innocent languit; sa fermeté, du reste, et son calme ne l’abandonnèrent pas, quoiqu’il n’eût pour toute distraction, en attendant la mort, que de regarder un peu au dehors, et d’entendre au loin hurler les chiens de garde et crier les hiboux de la tour.
« Sans ma curiosité, disait-il, je serais libre et courant à ma fantaisie dans le jardin de mes parents. Oh ! ma bonne mère, je ne te reverrai plus ! »
Au moment où il s’enfonçait dans ses souvenirs d’enfance, se rappelant jusqu’aux plus petits détails de cette heureuse époque de sa vie, un juge chargé de lui lire sa sentence s’approcha de la souricière.
XXVII
CONDAMNATION DE TOM POUCE.
Le tribunal l’avait tout d’une voix condamné à avoir la tête tranchée ; et telle était la frayeur qu’inspirait la colère du roi, que, quand les causes les plus injustes trouvent des défenseurs, la juste cause de Pouce n’en avait pas trouvé !
On raconte que quand on annonça à l’exécuteur des hautes œuvres, qui pourtant était un géant, qu’il allait avoir à mettre à mort l’infortuné Tom Pouce, son cœur de tigre fut attendri, et qu’il fut obligé de se faire servir quelque chose pour ne pas s’évanouir.
Pour Tom, une pareille nouvelle était bien faite pour lui causer une grande émotion ; il fit un tel soubresaut, qu’il brisa la souricière, et, se jetant alors sur le juge, il lui arracha des mains l’inique sentence, puis, s’en étant faite une espèce de ballon, il s’y accrocha, et, grâce à un vent très fort qui soufflait en ce moment, s’éleva dans l’air, aux acclamations du peuple, qui lui portait beaucoup d’intérêt.
La reine des fées, qui veillait sur lui, lui envoya alors un de ses papillons, sur le dos duquel il s’assit, et qui l’emmena dans le royaume des fées, à la barbe des satellites du roi Arthur.
On assure, du reste, qu’au moment où le pauvre Tom avait échappé à la mort d’une façon si miraculeuse, le roi Arthur, reconnaissant tout à coup son innocence, lui avait envoyé sa grâce. Mais il n’était plus temps. Tom était perdu pour lui. Et c’est ainsi que ce grand roi, si grand qu’il fût, trouva dans la perte de son petit favori le châtiment que méritait son aveugle emportement.
XXVIII
CONCLUSION.
Le papillon guida son léger fardeau jusqu’au palais de la reine des fées, où Tom était attendu.
Et ce fut là qu’il reçut sa récompense ; car, sans parler d’une brillante réception qui lui fut faite par toutes les fées, que sa marraine avait réunies pour fêter l’arrivée d’un si bon fils, il y trouva son père et sa mère, que la bonne fée y avait fait venir, et en outre la cabane, le jardin, le champ, et la vache elle-même qu’elle y avait transportés d’un seul coup de baguette. Tout était encore dans l’état où Tom l’avait laissé, si ce n’est pourtant le sabot, que madame Pouce avait usé pendant le temps où elle avait désespéré de revoir son cher petit Pouce, et qui avait été remplacé par un nid de roitelet.
La bonne fée garda dans son palais cette aimable famille, ils y vécurent tous heureux jusque dans un âge avancé.
Et s’ils ne sont pas morts, ils vivent encore.
EPILOGUE.
L’histoire de Tom était finie.
Tous les enfants s’étaient peu à peu rapprochés de leur grand’maman.
«Tom Pouce était brave, dit Octave. — Il aimait bien sa maman, dit Jules. — Déjà fini ! dit Valentine. — Encore, dit Anna. — C’est bien joli, dit la petite Marie. — Ma poupée a été bien sage, » s’écria Marguerite à son tour.
Le petit Jean Paul dormait.
«Allons nous coucher, dit la bonne maman, et puisque, vous avez été de bons petits enfants, je vous conterai dès demain, une autre histoire, qui sera bien plus jolie encore que celle de Tom Pouce, car celui de qui je la tiens n’en sait que de belles. »
 Tags : tom, qu’il, poule, petit, bien
Tags : tom, qu’il, poule, petit, bien
-
Commentaires
Apprendre à vivre des mondes


 Lectures analysées - Dumas 1
Lectures analysées - Dumas 1 Fiches de lecture CP-CE1
Fiches de lecture CP-CE1 La Chanson de Roland
La Chanson de Roland Abeille (A. France)
Abeille (A. France) Aladdin et la lampe magique (1001 Nuits)
Aladdin et la lampe magique (1001 Nuits) Choix de fables CM (Berry)
Choix de fables CM (Berry)
 20 000 lieues sous les mers (Verne)
20 000 lieues sous les mers (Verne)