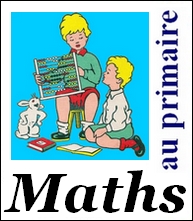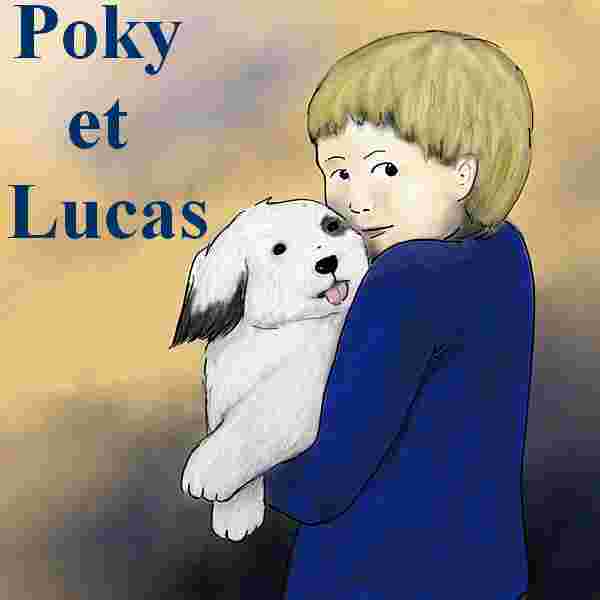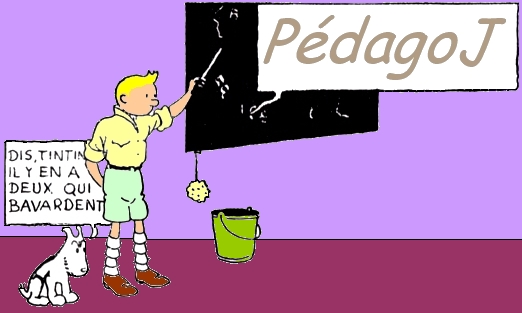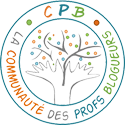-
Par Spinoza1670 le 19 Avril 2012 à 17:24
Cette histoire fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 14 - le petit patre.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 14 - le petit patre.rtf »
LE PETIT PÂTRE.
Un petit pâtre s’était rendu célèbre par la sagesse avec laquelle il répondait aux questions qui lui étaient adressées. Le bruit de sa réputation parvint jusqu’aux oreilles du roi qui n’en voulut rien croire, fit venir le petit garçon, et lui dit :
— Si tu parviens à répondre aux questions que je vais te poser, je te regarderai désormais comme mon fils, et tu habiteras près de moi dans mon palais.
— Sire, quelles sont ces trois questions ? demanda le jeune pâtre.
— Voici d’abord la première, reprit le roi : Combien de gouttes d’eau y a-t-il dans la mer ?
Le petit pâtre répondit :
— Sire, commencez par faire boucher tous les fleuves et les rivières de la terre, de manière qu’il n’en coule plus une seule goutte d’eau dans la mer jusqu’à ce que j’aie fait mon calcul ; alors je vous dirai combien la mer renferme de gouttes.
Le roi reprit :
— Ma seconde question est celle-ci : Combien y a-t-il d’étoiles dans le ciel ? Le petit pâtre répondit :
— Sire, donnez-moi une grande feuille de papier blanc.
Puis le jeune garçon fit avec une plume un si grand nombre de petits points serrés sur toute la surface du papier, et si fins, qu’on les apercevait à peine et qu’il était de toute impossibilité de les compter ; rien qu’à vouloir l’essayer, les yeux étaient éblouis. Cette besogne terminée, il dit au roi :
— Il y a autant d’étoiles dans le ciel, que de points sur cette feuille de papier ; daignez les compter.
Personne n’y put réussir.
Le roi prenant de nouveau la parole :
— Ma troisième question a pour but de savoir de combien de secondes se compose l’éternité.
Le jeune pâtre répondit :
— Au delà de la Poméranie se trouve la montagne de diamant. Cette montagne a une lieue de hauteur, une lieue de largeur et une lieue de profondeur. Tous les cent ans, un oiseau vient s’y poser, gratte la montagne avec son bec et enlève une parcelle de diamant ; quand il aura de la sorte fait disparaître le mont tout entier, la première seconde de l’éternité sera écoulée.
Le roi repartit :
— Tu as répondu comme un sage à mes trois questions ; désormais tu resteras près de moi dans mon palais, et je te regarderai comme mon fils.
¾¾¾¾¾¾
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 19 Avril 2012 à 17:13
Cette histoire fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 13 - le clou.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 13 - le clou.rtf »
LE CLOU.
Un marchand avait fait de bonnes affaires à la foire ; il avait vendu toutes ses marchandises, et bien garni son sac de monnaies d’or et d’argent. Il s’était mis en route vers sa demeure où il désirait arriver ce même jour encore avant la tombée de la nuit. Il cheminait donc à cheval, son lourd portemanteau solidement attaché derrière la selle.
Vers l’heure du dîner, il fit halte dans une ville, et lorsqu’il voulut se remettre en route, le valet d’écurie, qui lui amena son cheval, lui dit :
— Monsieur ne sait pas sans doute qu’il manque un clou au fer gauche de derrière son cheval.
— Ne t’en inquiète pas, répondit le marchand, le fer n’en tiendra pas moins pendant les six lieues au plus qu’il reste à faire. Je suis pressé.
Vers l’heure du goûter, il s’arrêta de nouveau pour faire donner l’avoine à sa monture. Le garçon d’écurie ne tarda pas à venir le trouver dans l’auberge.
— Monsieur ne sait pas, sans doute, lui dit-il, qu’il manque un fer au pied gauche de derrière de son cheval. Dois-je le conduire chez le maréchal ?
— Ne t’en inquiète pas, répondit le marchand, pour une couple de lieues qu’il me reste à faire, mon cheval se passera bien de ce fer. Je suis pressé.
Il se remit en route. Mais bientôt après le cheval boita ; il n’y avait pas longtemps qu’il boitait, lorsqu’il commença à trébucher ; il eut à peine trébuché deux ou trois fois, qu’il s’abattit et se cassa une jambe. Le marchand fut obligé de laisser là son cheval gisant, de déboucler son portemanteau, de le placer sur son dos et de regagner à pied son logis, où il n’arriva que très avant dans la nuit.
C’est pourtant ce maudit clou que j’ai négligé de faire remettre, qui a été cause de tout mon malheur, pensait-il en marchant d’un air sombre.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 19 Avril 2012 à 17:09
Cette hsitoire fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 12 - les trois faineants.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 12 - les trois faineants.rtf »
LES TROIS FAINÉANTS.
Un roi avait trois fils qu’il aimait également, et il ne savait auquel d’entre eux laisser sa couronne. Lorsqu’il se sentit près de mourir, il les fit venir, et leur dit :
— Mes chers enfants, il est temps que je vous fasse connaître ma dernière volonté : j’ai décidé que celui d’entre vous qui serait le plus fainéant, hériterait de mes états.
A ces mots, l’aîné prenant la parole :
— C’est donc à moi, mon père, dit-il, que revient votre sceptre ; car je suis tellement fainéant, que, le soir, j’ai beau tomber de fatigue et de sommeil, je n’ai pas le courage de fermer mes yeux pour dormir.
Le cadet dit à son tour :
— C’est donc à moi, mon père, qu’appartient votre couronne, car je suis si fainéant, que lorsque je me trouve assis devant le feu, et que je sens la flamme me brûler les jambes, j’aime mieux les laisser rôtir, que de faire un mouvement pour les retirer.
Le troisième reprit :
— Mon père, personne plus que moi n’a droit à vous succéder, car telle est ma fainéantise que si j’étais condamné à être pendu, que j’eusse déjà la corde autour du cou, et qu’au moment d’être étranglé, que quelqu’un me tendit un couteau pour couper la corde, je préférerais subir mon triste sort plutôt que de me déranger pour prendre ce couteau.
Le roi répondit aussitôt :
— C’est à toi que revient ma couronne.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 19 Avril 2012 à 17:04
Cette histoire fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 11 - l-aieul et le petit-.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 11 - l-aieul et le petit-.rtf »
------
L’AÏEUL ET LE PETIT-FILS.
Il y avait une fois un homme vieux, vieux comme les pierres. Ses yeux voyaient à peine, ses oreilles n’entendaient guère, et ses genoux chancelaient. Un jour, à table, ne pouvant plus tenir sa cuiller, il répandit de la soupe sur la nappe, et même un peu sur sa barbe.
Son fils et sa bru en prirent du dégoût, et désormais le vieillard mangea seul, derrière le poêle, dans un petit plat de terre à peine rempli. Aussi regardait-il tristement du côté de la table, et des larmes roulaient sous ses paupières ; si bien qu’un autre jour, échappant à ses mains tremblantes, le plat se brisa sur le parquet.
Les jeunes gens le grondèrent, et le vieillard poussa un soupir ; alors ils lui donnèrent pour manger une écuelle de bois.
Or, un soir qu’ils soupaient à table, tandis que le bonhomme était dans son coin, ils virent leur fils, âgé de quatre ans, assembler par terre de petites planches.
— Que fais-tu là ? lui demandèrent-ils.
— Une petite écuelle, répondit le garçon, pour faire manger papa et maman quand je serai marié.....
L’homme et la femme se regardèrent en silence... ; des larmes leur vinrent aux yeux. Ils rappelèrent entre eux l’aïeul qui ne quitta plus la table de famille.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 12:58
Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 10 - les trois freres.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 10 - les trois freres.rtf »
LES TROIS FRÈRES.
Un vieillard avait trois fils, mais comme il ne possédait pour tout bien qu’une maison, et que cette maison lui avait été léguée par son père, il ne pouvait se résoudre à la vendre pour en partager le produit entre ses enfants. Dans cette incertitude, il lui vint une bonne idée :
— Risquez-vous par le monde, leur dit-il un jour ; allez apprendre chacun un métier qui vous fasse vivre, et, votre apprentissage terminé, hâtez-vous de revenir ; celui qui me donnera alors la preuve la plus convaincante de son savoir-faire, héritera de ma maison.
En conséquence, le départ des trois fils fut arrêté. Ils décidèrent qu’ils deviendraient, l’un maréchal-ferrant, l’autre barbier, et le troisième maître d’armes.
Ils fixèrent ensuite un jour et une heure où ils se retrouveraient dans la suite, pour revenir ensemble sous le toit paternel. Ces conventions arrêtées, ils partirent.
Or, il arriva que les trois frères eurent le bonheur de rencontrer chacun un maître consommé dans le métier qu’ils voulaient apprendre.
C’est ainsi que notre maréchal-ferrant ne tarda pas à être chargé de ferrer les chevaux du roi ; aussi pensa-t-il dans sa barbe :
— Mes frères seront bien habiles s’ils me disputent la maison.
De son côté, le jeune barbier eut bientôt pour pratiques les plus grands seigneurs de la cour, si bien qu’il se flattait aussi d’hériter de la maison à la barbe de ses frères.
Quant au maître d’armes, avant de connaître tous les secrets de son art, il dut recevoir plus d’un bon coup d’estoc et de taille ; mais la récompense promise soutenait son courage, en même temps qu’il exerçait son œil et sa main.
Quand l’époque fixée pour le retour fut arrivée, les trois frères se réunirent à l’endroit convenu, puis ils regagnèrent ensemble la maison de leur père.
Le soir même de leur retour, tandis qu’ils étaient assis tous quatre devant la porte, ils aperçurent un lièvre qui accourait à travers champs de leur côté.
— Bravo ! dit le barbier, voici une pratique qui vient fort à propos pour me fournir l’occasion de montrer mon savoir-faire !
En prononçant ces mots, notre homme prenait savon et bassin et préparait sa blanche mousse.
Quand le lièvre fut parvenu à proximité, il courut à sa poursuite, le rejoignit, et tout en galopant de concert avec le léger animal, il lui barbouilla le nez de savon, puis d’un seul coup de rasoir il lui enleva la moustache, sans lui faire la plus petite coupure, et sans oublier le plus petit poil.
— Voilà qui est travaillé ! dit le père. Il faudra que tes frères soient bien habiles pour te disputer la maison.
Quelques moments après, on vit arriver à toute bride un cheval fringant attelé à une légère voiture.
— Je vais vous donner un échantillon de mon adresse, dit à son tour le maréchal-ferrant.
A ces mots, il s’élança sur la trace du cheval, et bien que celui-ci redoublât de vitesse, il lui enleva les quatre fers auquel il en substitua quatre autres ; et tout cela en moins d’une minute, le plus aisément du monde et sans ralentir la course du cheval.
— Tu es un artiste accompli, s’écria le père ; tu es aussi sûr de ton affaire, que ton frère l’est de la sienne ; et je ne saurais en vérité décider lequel de vous deux mérite le plus la maison.
— Attendez que j’aie aussi fait mes preuves, dit alors le troisième fils.
La pluie commençait à tomber en ce moment.
Notre homme tira son épée, et se mit à en décrire des cercles si rapides au-dessus de sa tête, que pas une seule goutte d’eau ne tomba sur lui ; la pluie redoublant de force, ce fut bientôt comme si on la versait à seaux des hauteurs du ciel. Cependant notre maître d’armes qui s’était borné à agiter son épée toujours plus vite, demeurait à sec sous son arme, comme s’il eût été sous un parapluie ou sous un toit.
A cette vue, l’admiration de l’heureux père fut au comble, et il s’écria :
— C’est toi qui as donné la preuve d’adresse la plus étonnante ; c’est à toi que revient la maison.
Les deux fils aînés approuvèrent cette décision, et joignirent leurs éloges à ceux de leur père. Ensuite, comme ils s’aimaient tous trois beaucoup, ils ne voulurent pas se séparer, et continuèrent de vivre ensemble dans la maison paternelle, où ils exercèrent chacun leur métier. Leur réputation d’habileté s’étendit au loin, et ils devinrent bientôt riches. C’est ainsi qu’ils vécurent heureux et considérés jusqu’à un âge très-avancé ; et lorsqu’enfin l’aîné tomba malade et mourut, les deux autres en prirent un tel chagrin qu’ils ne tardèrent pas à le suivre.
On leur rendit les derniers devoirs. Le pasteur de la commune fit observer avec raison que trois frères qui, pendant leur vie avaient été doués d’une si grande adresse et unis par une si touchante amitié, ne devaient pas non plus être séparés dans la mort. En conséquence, on les plaça tous trois dans le même tombeau.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 12:41
Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 08 - le loup et le renard.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 08 - le loup et le renard.rtf »
LE LOUP ET LE RENARD.
Certain loup s’était fait le compagnon de certain renard, et les moindres désirs de sa seigneurie le loup devenaient des ordres pour son très-humble serviteur le renard, car celui-ci était le plus faible. Aussi désirait-il de tout son coeur pouvoir se débarrasser d’un camarade aussi gênant.
Tout en rôdant de compagnie, ils arrivèrent un jour dans une forêt profonde.
— Ami à barbe rouge, lui dit le loup, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau ; sinon, je te croque.
Maître renard s’empressa de répondre :
— Seigneur loup, je sais à peu de distance d’ici une étable où se trouvent deux agneaux friands ; si le coeur vous en dit, nous irons en dérober un.
La proposition plut au loup. En conséquence, nos deux compagnons se dirigèrent vers la ferme indiquée ; le rusé renard parvint sans peine à dérober un des agneaux qu’il s’empressa d’apporter au loup ; puis il s’éloigna.
Aussitôt le loup se mit en devoir de dévorer à belles dents l’innocente bête ; et quand il eut fini, ce qui ne tarda guère, ne se sentant pas encore suffisamment repu, il se prit à penser que ce ne serait pas trop du second agneau pour apaiser sa faim. Il se décida donc à entreprendre lui-même cette nouvelle expédition.
Or, comme sa seigneurie était un peu lourde, elle renversa un balai en entrant dans l’étable, si bien que la mère du pauvre agneau poussa aussitôt des bêlements si déchirants, que le fermier et ses garçons accoururent en toute hâte. Maître loup passa alors un mauvais quart d’heure : il sentit pleuvoir sur son dos une grêle de coups si drue, qu’il eut toutes les peines du monde à se sauver en boitant, et en hurlant de la manière la plus lamentable.
Arrivé près du renard :
— Tu m’as conduit dans un beau guêpier, lui dit-il ; j’avais voulu m’emparer du deuxième agneau ; mais est-ce que ces paysans mal appris ne se sont pas avisés de fondre sur moi à grands coups de bâton, ce qui m’a réduit au fâcheux état où tu me vois.
— Pourquoi aussi êtes-vous si insatiable ? répondit le renard.
Le jour suivant, ils se remirent en campagne, et s’adressant à son rusé compagnon :
— Ami à barbe rouge, lui dit le loup, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau, sinon je te croque.
Maître renard s’empressa de répondre :
— Seigneur loup, je connais une ferme dont la fermière est présentement occupée à faire des gâteaux délicieux ; si vous voulez, nous irons en dérober quelques-uns ?
— Marche en avant, répliqua le loup.
Ils se dirigèrent donc vers la ferme en question, et quand ils y furent arrivés, le renard poussa des reconnaissances autour de la place qu’il s’agissait d’enlever. Il fureta si bien, qu’il finit par découvrir l’endroit où la ménagère cachait ses gâteaux, en déroba une demi-douzaine, et courut les porter au loup.
— Voilà de quoi régaler votre seigneurie, dit-il.
Puis il s’éloigna.
Le loup ne fit qu’une bouchée des six gâteaux qui, loin de le rassasier, aiguillonnèrent encore son appétit.
— Cela demande à être goûté plus à loisir ! rumina-t-il.
En conséquence, il entra dans la ferme d’où il avait vu sortir le renard, et parvint dans l’office où se trouvaient les gâteaux. Mais dans son avidité, il voulut tirer à lui tout le plat qui tomba sur le carreau, et vola en pièces en occasionnant un grand fracas.
Attirée soudain par un tel vacarme, la fermière aperçut le loup et appela ses gens. Ceux-ci accoururent sur-le-champ, et cette fois encore maître loup fut rossé d’importance.
Boitant de deux pattes et poussant des hurlements capables d’attendrir un rocher, il rejoignit le renard dans la forêt :
— Dans quel horrible guêpier m’as-tu de nouveau conduit ? lui dit-il. Il se trouvait là des rustres qui m’ont cassé leurs bâtons sur le dos.
— Pourquoi votre seigneurie est-elle si insatiable ? répondit le renard.
Le lendemain, les deux compagnons se mirent pour la troisième fois en campagne, et, bien que le loup ne pût encore marcher que clopin clopant, s’adressant de nouveau au renard :
— Ami à la barbe rouge, lui dit-il, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau ; sinon je te croque.
Le renard s’empressa de répondre.
— Je connais un homme qui vient de saler un porc ; le lard savoureux se trouve en ce moment dans un tonneau de sa cave ; si vous voulez, nous irons en prélever notre part ?
— J’y consens, répliqua le loup, mais j’entends que nous y allions ensemble, pour que tu puisses me prêter secours en cas de malheur.
— De tout mon coeur, reprit le rusé renard.
Et il se mit immédiatement en devoir de conduire le loup par une foule de détours et de sentiers jusque dans la cave annoncée.
Ainsi que le renard l’avait prédit, jambon et lard se trouvaient là en abondance. Le loup fut bientôt à l’œuvre :
— Rien ne nous presse, dit-il, donnons-nous-en donc tout à notre aise !
Maître renard se garda bien d’interrompre son compagnon dans ses fonctions gloutonnes : mais quant à lui, il eut toujours l’œil et l’oreille au guet ; de plus, chaque fois qu’il avait avalé un morceau, il s’empressait de courir à la lucarne par laquelle ils avaient pénétré dans la cave, afin de prendre la mesure de son ventre.
Étonné de ce manège, le loup lui dit entre deux coups de dents.
— Ami renard, explique-moi donc pourquoi tu perds ainsi ton temps à courir de droite à gauche, puis à passer et à repasser par ce trou ?
— C’est pour m’assurer que personne ne vient, reprit le rusé renard. Que votre seigneurie prenne seulement garde de se donner une indigestion.
— Je ne sortirai d’ici, répliqua le loup, que lorsqu’il ne restera plus rien dans le tonneau.
Dans l’intervalle, arriva le paysan, attiré par le bruit que faisaient les bonds du renard. Ce dernier n’eut pas plutôt aperçu notre homme, qu’en un saut il fut hors de la cave ; sa seigneurie le loup voulut le suivre, mais par malheur, il avait tant mangé que son ventre ne put passer par la lucarne, et qu’il y resta suspendu. Le paysan eut donc tout le temps d’aller chercher une fourche dont il perça le pauvre loup.
Sans sa gloutonnerie, se dit le renard, en riant dans sa barbe, je ne serais pas encore débarrassé de cet importun compagnon.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 12:39
Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 09 - la chouette.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 09 - la chouette.rtf »
LA CHOUETTE.
Il y a environ quelques siècles, lorsque les hommes n’étaient pas encore aussi fins et aussi rusés qu’ils le sont aujourd’hui, il arriva une singulière histoire dans je ne sais plus quelle petite ville, fort peu familiarisée, comme on va le voir, avec les oiseaux nocturnes.
A la faveur d’une nuit très obscure, une chouette, venue d’une forêt voisine, s’était introduite dans la grange d’un habitant de la petite ville en question, et, quand reparut le jour, elle n’osa pas sortir de sa cachette, par crainte des autres oiseaux qui n’auraient pas manqué de la saluer d’un concert de cris menaçants.
Or, il arriva que le domestique vint chercher une botte de paille dans la grange ; mais à la vue des yeux ronds et brillants de la chouette tapie dans un coin, il fut saisi de frayeur, qu’il prit ses jambes à son cou, et courut annoncer à son maître qu’un monstre comme il n’en avait encore jamais vu se tenait caché dans la grange, qu’il roulait dans ses orbites profondes des yeux terribles, et qu’à coup sûr cette bête avalerait un homme sans cérémonie et sans difficulté.
— Je te connais, beau masque, lui répondit son maître ; s’il ne s’agit que de faire la chasse aux merles dans la plaine, le coeur ne te manque pas ; mais aperçois-tu un pauvre coq étendu mort contre terre, avant de t’en approcher, tu as soin de t’armer d’un bâton. Je veux aller voir moi-même à quelle espèce de monstre nous allons avoir affaire.
Cela dit, notre homme pénétra d’un pied hardi dans la grange, et se mit à regarder en tous sens.
Il n’eut pas plutôt vu de ses propres yeux l’étrange et horrible bête, qu’il fut saisi d’un effroi pour le moins égal à celui de son domestique. En deux bonds il fut hors de la grange, et courut prier ses voisins de vouloir bien lui prêter aide et assistance contre un monstre affreux et inconnu :
— Il y va de votre propre salut, leur dit-il ; car si ce terrible animal parvient à s’évader de ma grange, c’en est fait de la ville entière !
En moins de quelques minutes, des cris d’alarme retentirent par toutes les rues ; les habitants arrivèrent armés de piques, de fourches et de faux, comme s’il se fût agi d’une sortie contre l’ennemi ; puis enfin parurent, en grand costume et revêtus de leur écharpe, les conseillers de la commune avec le bourgmestre en tête. Après s’être mis en rang sur la place, ils s’avancèrent militairement vers la grange qu’ils cernèrent de tous côtés. Alors le plus courageux de la troupe sortit du cercle, et se risqua à pénétrer dans la grange, la pique en avant; mais on l’en vit ressortir aussitôt à toutes jambes, pâle comme la mort, et poussant de grands cris.
Deux autres bourgeois intrépides osèrent encore après lui tenter l’aventure, mais ils ne réussirent pas mieux.
A la fin, on vit se présenter un homme d’une stature colossale et d’une force prodigieuse. C’était un ancien soldat qui, par sa bravoure, s’était fait une réputation à la guerre.
— Ce n’est pas en allant vous montrer les uns après les autres, dit-il, que vous parviendrez à vous débarrasser du monstre ; il s’agit ici d’employer la force, mais je vois avec peine que la peur a fait de vous autant de femmes. Cela dit, notre valeureux guerrier se fit apporter cuirasse, glaive et lance, puis il s’arma en guerre.
Chacun vantait son courage, quoique presque tous fussent persuadés qu’il courait à une mort certaine.
Les deux portes de la grange furent ouvertes, et l’on put voir alors la chouette qui était allée se poser sur une poutre du milieu. Le soldat se décida à monter à l’assaut. En conséquence, on lui apporta une échelle qu’il plaça contre la poutre.
Au moment où il s’apprêtait à monter, ses camarades lui crièrent en coeur de se conduire en homme ; puis, ils le recommandèrent à saint Georges qui, chacun le sait, dompta jadis le dragon.
Quand il fut parvenu aux trois quarts de l’échelle, la chouette qui s’aperçut qu’on en voulait à sa noble personne, et que d’ailleurs les clameurs de la foule avait effarouchée, ne sachant de quel côté s’enfuir, se mit soudain à rouler de grands yeux, hérissa ses plumes, déploya ses vastes ailes, déserra son bec hideux, et poussa trois cris sauvages, d’une voix rauque et effrayante.
— Frappez-la de votre lance ! s’écrièrent au même instant du dehors les bourgeois électrisés.
— Je voudrais bien vous voir à ma place, répondit le belliqueux aventurier ; je gage qu’alors vous ne seriez pas si braves.
Toutefois, il monta encore d’un degré sur l’échelle ; après quoi, la peur s’empara de lui, si bien qu’il lui resta tout au plus assez de force pour redescendre jusqu’au bas.
Dès lors, il ne se trouva plus personne pour affronter le danger.
— Au moyen de sa seule haleine et par la fascination de son regard, disaient-ils tous, cet horrible monstre a pénétré de son venin et blessé à mort le plus robuste d’entre nous ; à quoi nous servirait donc de nous exposer à une mort certaine ?
D’accord sur ce point, ils tinrent conseil à l’effet de savoir ce qu’il y avait à faire pour préserver la ville d’une ruine imminente. Pendant longtemps tous les moyens avaient été jugés insuffisants, lorsqu’enfin par bonheur le bourgmestre eut une idée.
— Mon avis est, dit ce respectable citoyen, que nous dédommagions, au nom de la commune, le propriétaire de cette grange ; que nous lui payions la valeur de tous les sacs d’orge et de blé qu’elle renferme ; puis, que nous y mettions le feu, aux quatre coins, ce qui ne coûtera la vie à personne. Ce n’est pas dans une circonstance aussi périlleuse qu’il faut se montrer avare des deniers publics ; et d’ailleurs il s’agit ici du salut commun.
L’avis du bourgmestre fut adopté à l’unanimité.
En conséquence, le feu fut mis aux quatre coins de la grange, qui bientôt fut entièrement consumée, tandis que la chouette s’envolait par le toit.
Si vous doutez de la vérité de ce récit, allez sur les lieux vous en informer vous-même.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 10:52
Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 07 - la douce bouillie.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 07 - la douce bouillie.rtf »
LA DOUCE BOUILLIE.
Une fille, pauvre mais vertueuse et craignant Dieu, vivait seule avec sa vieille mère. Leur misère était devenue si grande qu’elles se voyaient sur le point de mourir de faim.
Dans cette extrémité, la pauvre fille, toujours confiante en Dieu, sortit de leur misérable cabane, et pénétra dans le bois voisin.
Elle ne tarda pas à rencontrer une vieille femme qui, devinant (c’était une fée) la détresse de la jeune fille, lui donna un petit pot, bien précieux vraiment.
— Tu n’auras qu’à prononcer ces trois mots, dit la vieille : «petit pot, cuis !» Il se mettra aussitôt à te faire une douce et excellente bouillie de millet ; et quand tu auras dit : «petit pot, arrête-toi !» il s’arrêtera sur-le-champ.
La jeune fille s’empressa d’apporter à sa mère ce pot merveilleux. A partir de ce moment, l’indigence et la faim quittèrent leur humble cabane, et elles purent se régaler de bouillie tout à leur aise.
Il arriva qu’un jour la jeune fille dut aller faire une course hors du village. Pendant son absence la mère eut faim, et se hâta de dire :
— Petit pot, cuis.
Petit pot ne se le fit pas répéter, et la vieille eut bientôt mangé tout son soûl ; alors, la bonne femme voulut arrêter le zèle producteur du petit pot. Mais par malheur elle ignorait les mots qu’il fallait prononcer pour cela. Maître petit pot continua donc de cuire toujours plus et plus fort, si bien que la bouillie ne tarda pas à déborder du vase, puis à remplir la cuisine, puis à inonder la maison, puis la maison d’à côté, puis une autre, puis encore une autre, puis enfin toute la rue ; et du train dont il y allait, on eût dit qu’il voulait noyer le monde entier. Cela devenait d’autant plus effrayant, que personne ne savait comment s’y prendre pour arrêter ce déluge.
Heureusement qu’à la fin, comme il ne restait plus dans tout le village qu’une seule maison qui ne fût pas devenue la proie de la bouillie, la jeune fille revint et s’écria :
— Petit pot ! arrête-toi !
Et aussitôt petit pot s’arrêta.
Les habitants du village, qui désirèrent rentrer dans leurs maisons, n’en durent pas moins avaler beaucoup plus de bouillie qu’ils n’en voulaient.
Ce conte prouve qu’on fait toujours mal ce qu’on ne sait qu’à demi.
¾¾¾¾¾
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 10:49
Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 06 - le docteur universel.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 06 - le docteur universel.rtf »
LE DOCTEUR UNIVERSEL.
Il y avait une fois un paysan nommé Écrevisse. Ayant porté une charge de bois chez un docteur, il remarqua les mets choisis et les vins fins dont se régalait celui-ci, et demanda, en ouvrant de grands yeux, s’il ne pourrait pas aussi devenir docteur ?
— Oui certes, répondit le savant ; il suffit pour cela de trois choses : 1° procure-toi un abécédaire, c’est le principal ; 2° vends ta voiture et tes bœufs pour acheter une robe et tout ce qui concerne le costume d’un docteur ; 3° mets à ta porte une enseigne avec ces mots : Je suis le docteur universel.
Le paysan exécuta ces instructions à la lettre. A peine exerçait-il son nouvel état, qu’une somme d’argent fut volée à un riche seigneur du pays. Ce seigneur fait mettre les chevaux à sa voiture et vient demander à notre homme s’il est bien le docteur universel.
— C’est moi-même, monseigneur.
— En ce cas, venez avec moi pour m’aider à retrouver mon argent.
— Volontiers, dit le docteur ; mais Marguerite, ma femme, m’accompagnera.
Le seigneur y consentit, et les emmena tous deux dans sa voiture. Lorsqu’on arriva au château, la table était servie, le docteur fut invité à y prendre place.
— Volontiers, répondit-il encore ; mais Marguerite, ma femme, y prendra place avec moi.
Et les voilà tous deux attablés.
Au moment où le premier domestique entrait, portant un plat de viande, le paysan poussa sa femme du coude, et lui dit :
— Marguerite, celui-ci est le premier.
Il voulait dire le premier plat ; mais le domestique comprit : le premier voleur ; et comme il l’était en effet, il prévint en tremblant ses camarades.
— Le docteur sait tout ! notre affaire n’est pas bonne ; il a dit que j’étais le premier !
Le second domestique ne se décida pas sans peine à entrer à son tour ; à peine eut-il franchi la porte avec son plat, que le paysan, poussant de nouveau sa femme :
— Marguerite, voici le second.
Le troisième eut la même alerte, et nos coquins ne savaient plus que devenir. Le quatrième s’avance néanmoins, portant un plat couvert (c’étaient des écrevisses). Le maître de la maison dit au docteur :
— Voilà une occasion de montrer votre science. Devinez ce qu’il y a là-dedans.
Le paysan examine le plat, et, désespérant de se tirer d’affaire :
— Hélas ! soupire-t-il, pauvre Écrevisse ! (On se rappelle que c’était son premier nom.)
A ces mots, le seigneur s’écrie :
— Voyez-vous, il a deviné ! Alors il devinera qui a mon argent !
Aussitôt le domestique, éperdu, fait signe au docteur de sortir avec lui. Les quatre fripons lui avouent qu’ils ont dérobé l’argent, mais qu’ils sont prêts à le rendre et à lui donner une forte somme s’il jure de ne les point trahir ; puis ils le conduisent à l’endroit où est caché le trésor. Le docteur, satisfait, rentre, et dit :
— Seigneur, je vais maintenant consulter mon livre, afin d’apprendre où est votre argent.
Cependant un cinquième domestique s’était glissé dans la cheminée pour voir jusqu’où irait la science du devin. Celui-ci feuillette en tous sens son abécédaire, et ne pouvant y trouver un certain signe :
— Tu es pourtant là dedans, s’écrie-t-il avec impatience, et, il faudra bien que tu en sortes.
Le valet s’échappe de la cheminée, se croyant découvert, et crie avec épouvante :
— Cet homme sait tout ?
Bientôt le docteur montra au seigneur son argent, sans lui dire qui l’avait soustrait ; il reçut de part et d’autre une forte récompense, et fut désormais un homme célèbre.
¾¾¾¾¾¾
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 10:47
Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.
Télécharger « grimm contes famille 05 - le soleil qui rend t.pdf »
Télécharger « grimm contes famille 05 - le soleil qui rend t.rtf »
LE SOLEIL QUI REND TÉMOIGNAGE.
Un ouvrier tailleur voyageait de ville en ville pour se perfectionner dans son état. Les temps devinrent si difficiles, qu’il ne put plus trouver d’ouvrage, et qu’il tomba dans une misère profonde. Dans cette extrémité, il rencontra un juif au milieu d’un bois touffu ; et chassant de son coeur la pensée de Dieu, il le saisit au collet et lui dit :
— La bourse, ou la vie !
Le juif répondit :
— De grâce, laissez-moi la vie ; je ne suis d’ailleurs qu’un pauvre juif, et je n’ai que deux sous pour toute fortune.
Le tailleur crut que le juif lui en imposait ; et il reprit :
— Tu mens ; je suis sûr que ta bourse est bien garnie.
En achevant ces mots, il fondit sur le pauvre juif et lui asséna des coups si violents, que le malheureux tomba expirant contre terre. Sur le point de rendre le dernier soupir, le juif recueillit le peu qui lui restait de forces pour prononcer ces paroles :
— Le soleil qui a vu ton crime, saura bien en rendre témoignage !
Et le pauvre juif avait cessé d’exister.
Aussitôt l’ouvrier tailleur se mit à fouiller dans les poches de sa victime, mais il eut beau les retourner en tous sens, il n’y trouva que les deux sous annoncés par le juif.
Alors, il souleva le corps et alla le cacher derrière un buisson; après quoi, il poursuivit sa route, à la recherche d’une place.
Quand il eut voyagé longtemps de la sorte, il finit par trouver à s’employer dans une ville chez un maître tailleur qui avait une très belle fille. Le jeune apprenti ne tarda pas à en devenir épris, la demanda en mariage, et l’épousa. Et ils vécurent heureux.
Longtemps après, son beau-père et sa belle-mère moururent, et le jeune couple hérita de leur maison. Un matin, tandis que notre tailleur était assis, les deux jambes croisées sur la table, et regardait par la fenêtre, sa femme lui apporta son café. Il en versa une partie dans sa soucoupe, et comme il se disposait à boire, un rayon de soleil vint se jouer à la surface de la liqueur, puis remonta vers les bords en traçant des dessins fantastiques. Le tailleur, à qui sa conscience rappelait sans cesse les dernières paroles du juif, marmotta entre ses dents :
— Voilà un rayon qui voudrait bien rendre témoignage, mais il lui manque la voix !
— Que murmures-tu là dans ta barbe ? lui demanda avec étonnement sa femme.
Le tailleur fort embarrassé par cette question, répondit :
— Ne le demande pas ; c’est un secret.
Mais la femme reprit :
— Entre nous il ne doit pas y avoir place pour un secret. Tu me confieras celui-ci, ou je croirai que tu ne m’aimes pas.
Et la femme accompagna cette réponse insidieuse des plus belles promesses de discrétion : elle ensevelirait ce secret dans son sein ; elle ne lui en parlerait même jamais plus. Bref, elle fit si bien, que le tailleur lui avoua que jadis, dans ses années de compagnonnage, un jour, égaré par la misère et la faim, il avait fait tomber sous ses coups, pour le dévaliser, un malheureux juif ; et qu’au moment de rendre le dernier soupir, ce juif lui avait dit :
— Le soleil qui a vu ton crime saura bien en rendre témoignage!
— Et c’est à quoi je faisais allusion tout à l’heure, poursuivit le tailleur, en voyant le soleil s’évertuer à faire des ronds dans ma tasse ; mais je t’en supplie, veille bien sur ta langue ; songe qu’un seul mot pourrait me perdre.
La femme jura ses grands dieux qu’elle se montrerait digne de recevoir un secret.
Or, son mari s’était à peine remis au travail, qu’elle courut en toute hâte chez sa marraine, à qui elle raconta ce qu’elle venait d’apprendre, en lui recommandant bien de n’en souffler mot à qui que ce soit. Le lendemain, ce secret était celui de la ville entière ; si bien, que le tailleur fut cité à comparaître devant le juge, qui le condamna à la peine qu’il méritait.
Et c’est ainsi que le soleil, qui voit tous les crimes, finit toujours par en rendre témoignage.
¾¾¾¾¾¾
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Apprendre à vivre des mondes


 Lectures analysées - Dumas 1
Lectures analysées - Dumas 1 Fiches de lecture CP-CE1
Fiches de lecture CP-CE1 La Chanson de Roland
La Chanson de Roland Abeille (A. France)
Abeille (A. France) Aladdin et la lampe magique (1001 Nuits)
Aladdin et la lampe magique (1001 Nuits) Choix de fables CM (Berry)
Choix de fables CM (Berry)
 20 000 lieues sous les mers (Verne)
20 000 lieues sous les mers (Verne)